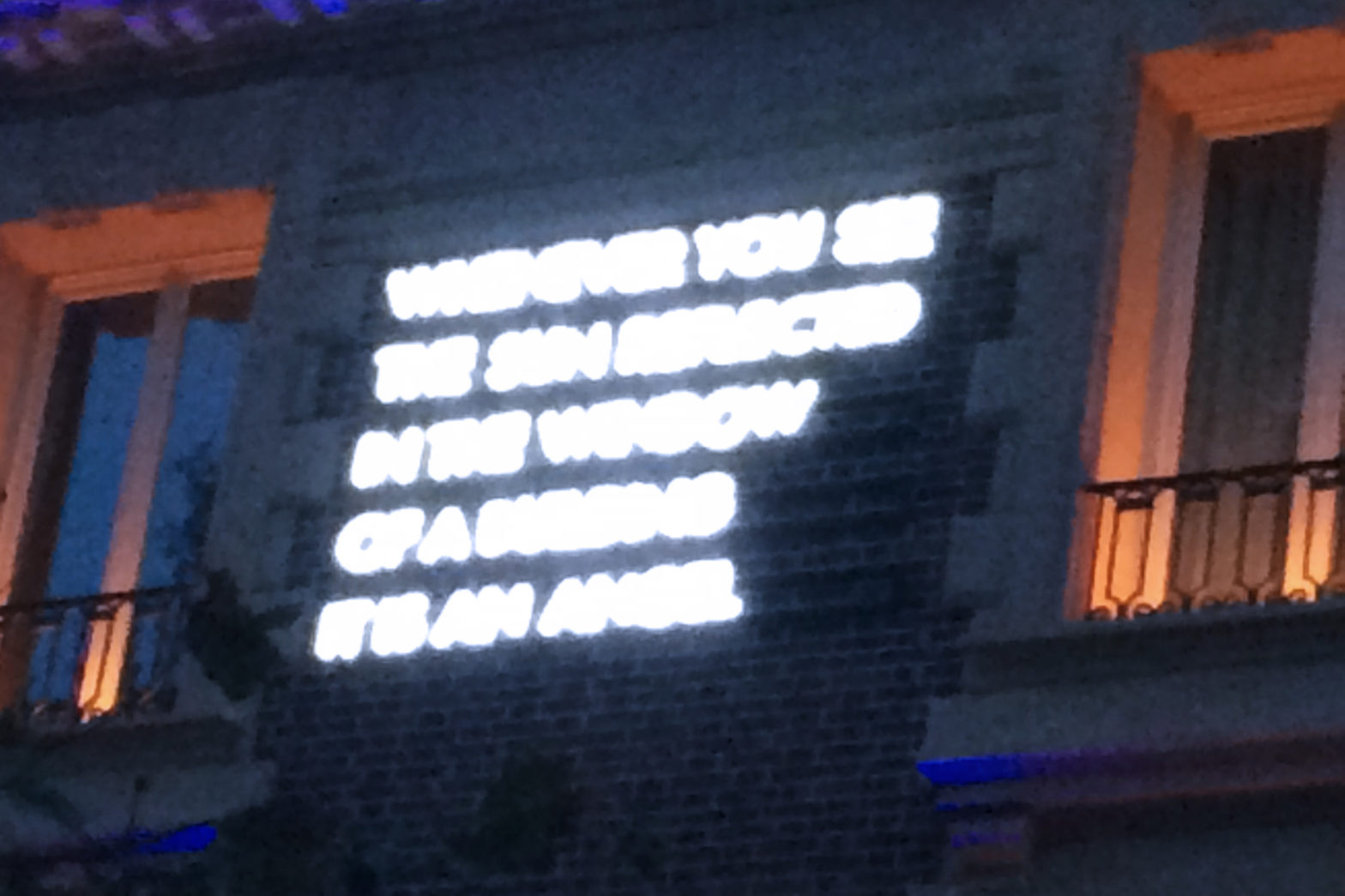Notre vocabulaire et notre langue fondent notre façon de penser. En les faisant évoluer, nous pouvons faire évoluer notre manière d’être.
Ils nous portent ou nous effraient, nous consolent ou nous encouragent, nous accablent ou nous élèvent. Surtout, ils révèlent notre capacité de penser, avec son ampleur ou ses limites, ses champs de réflexion et de connaissance. Eux ? Les mots. Ces phonèmes présents à nos oreilles avant même que nous naissions – le bébé in utero est déjà “pris” dans le bain de langage de ses parents, qu’il perçoit de manière vibratoire à travers la membrane placentaire- au point que le neuropsychiatre Boris Cyrulnik affirmait dans une récente conférence : “Nous sommes parlés avant de parler”.
À sa naissance, le nourrisson perçoit près de 3 000 mots, puis retient et comprend 160 phonèmes de la langue maternelle. “Le cerveau, littéralement sculpté par le langage, réduit alors son activité et apprend à fonctionner à l’économie, poursuit le psychiatre. Nous sommes façonnés ainsi par notre milieu, mais quand arrive la traversée du ‘Rubicon de la parole’, quand les bébés se mettent peu à peu à parler, entre les 20è et 30è mois, alors les déterminants peuvent changer”.
Plus de mots, c’est d’emblée plus de liberté. Liberté d’être, de se construire, de penser “à sa façon” grâce à la richesse lexicale qui va permettre de trouver le mot juste pour s’exprimer ou offrir des récits à l’autre. L’évolution des mots dans une langue révèlent donc celui qui parle. Elle dit aussi beaucoup de l’évolution sociétale. Quand des mots sont sortis de l’usage, il y a de quoi s’inquiéter, car cet effacement peut aussi indiquer un affaiblissement de sens.
Ainsi, la disparition du participe passé. Depuis 2016, son emploi à l’oral étant jugé trop compliqué et “discriminant”, les nouveaux programmes ont demandé aux professeurs d’enseigner ce temps verbal aux seules 3e personnes du singulier et du pluriel dans les classes de cycle 3 (CM1, CM2 et 6e).
Mais en ne disant plus “je chantai” ou “tu sautai”, n’en viendra-t-on pas peu à peu à effacer l’idée en chacun d’une action faite dans un moment précis ? Concernant cette disparition du passé simple, l’usage grammatical semble ici plier au profit de l’usage répandu via les nouvelles technologies, qui préfèrent le temps présent et le dialogue immédiat (cf. article du 3 janvier 2018 Le passé simple est-il condamné à disparaître ?). Il n’a donc rien d’anodin.
Heureusement, sachant que nous utilisons environ 5 000 mots en moyenne pour nous faire comprendre, que le vocabulaire quotidien, selon le milieu social et culturel, varie de 300 à 3 000 mots, alors que le dictionnaire de langue française répertorie environ 60 000 mots, la marge de progression reste donc phénoménale (source échelle Dubois-Buyse).
Mais pour les psychologues, le lexique ne se réduit pas à être un “listing” de vocabulaire. Il est à la fois un point d’appui de la pensée et un outil de connaissance, de soi et du monde. Ainsi, dans certaines thérapies il est recommandé d’observer son langage : les TCC par exemple, recommandent de noter combien de fois par jour la personne anxieuse emploie les “il faut”, “je dois” ou “j’aurais dû” afin de les remplacer peu à peu par des formules moins contraignantes : “je pourrais” ou “je choisis de”…
C’est dans la vie émotionnelle que le travail sur les mots se révèle le plus fructueux. En effet, si l’on se limite à connaître seulement les noms des six émotions de base (joie, colère, peur, tristesse, surprise, dégoût) on risque de passer à côté de tous les sentiments qui parfois nous habitent : la méfiance, le ressentiment, l’inquiétude, le doute, la sympathie, l’ardeur…Ne pas connaître leurs dénominations et les enjeux qu’elles pointent, c’est souvent manquer des pans entiers de sa sensibilité.
A l’inverse, ajouter de nouveaux mots à son vocabulaire peut faire fructifier celle-ci. Dans son beau livre “Il nous faudrait des mots nouveaux” (éd. du Cerf), le critique littéraire et écrivain Laurent Nunez nous offre de découvrir des termes de langue étrangère qui ouvrent notre palette émotionnelle et nous permettent enfin de “mettre des mots” sur des sentiments jusque là incompréhensibles. Ainsi Litost, en tchèque. Le mot désigne “un sentiment proche du découragement, né du spectacle de sa propre misère soudainement découverte” (Milan Kundera). Quant à Naz, terme de la langue urdu, il évoque “la fierté qui nous remplit de savoir que l’on est aimé plus que tout au monde”.
Aussi le livre de Boris Cyrulnik, magnifique, “La nuit, j’écrirai des soleils” (éd.Odile Jacob) est-il une démonstration de la puissance des mots dans des vies qui cherchent à se déployer. “Comment serait le monde, si nous n’avions pas des mots pour le voir ?”, demande-t-il. À quoi nous pourrions ajouter : “Comment penser notre vie intérieure, si nous n’avions les mots pour nous en approcher ?”.
Cet article, écrit par mes soins, est paru dans le Figaro du 18 octobre 2019.