Ardent lecteur de Baudelaire, l’auteur-compositeur qualifié ça et là de rimbaldien a distillé tout au long de sa carrière une écriture littéraire de la chanson. Mais pour ses deux premiers albums, désormais cultes et porteurs de son ADN poétique, c’est Bashō (1644-1695) que l’auvergnat avait choisi pour compagnon. Cette influence de la poésie haïku colore de manière inaltérable l’univers tendre et singulier du chanteur.
Quand la comète Cheyenne autumn, premier album-concept d’un quasi inconnu, nommé Jean-Louis Murat, est arrivée dans notre ciel en 1989, je connaissais de loin la poésie haïku. Avec le recul je vois que tout ce qui me bouleversa alors dans les textes sensuels et quasi animistes de ce singulier chanteur des bords des rivières et volcans brumeux de son Auvergne natale était aussi ce qui m’entraînerait, des décennies plus tard, à suivre les maîtres japonais du poème bref.
Brume et pluie –
Fuji caché.
Mais cependant je vais content.
Matsuo Bashō [1]
Il a rencontré la fille, Bill
Elle rentrait de la ville
Trempée comme une jonquille
Neige et pluie au Sancy
Jean-Louis Murat, Neige et pluie au Sancy de l’album Babel (2014)
L’artiste lui-même l’a révélé : entre 1984 et 87, années noires et dépressives qui précèdent sa résurrection artistique, Murat reste en ermite dans sa ferme de Pessade et lit et relit Walt Withman — Feuilles d’herbes — et Bashō. Dans une interview, il citera d’ailleurs ceux-ci comme « ses deux auteurs préférés ». Quant au titre de son deuxième album-concept qui sort en 1991 , il est directement inspiré d’un recueil du japonais : Le manteau de pluie du singe.
Bashō, rappelons-le, est celui qui a fondé une poésie brève et démocratique dans le Japon du XVIIe siècle. Nourri de bouddhisme zen, il cherchait à capter l’évanescence, la simplicité, et la beauté des « choses ordinaires » quand la poésie dominante alors était dans la cour impériale et précieuse.
Mais il y a plus que le simple souci de référence : c’est à la fois l’esprit et l’écriture mêmes du haïku qui imprègnent alors l’univers muratien, d’où ce choc culturel avec un public français peu aguerri à cette poésie qu’on prenait de plein fouet en découvrant Cheyenne autumn.
bois morts et genêts
Il y avait d’abord cette immersion quasi viscérale dans le vivant, et sonnant tellement étrange à la fin des années quatre-vingts. Imaginez : Lio venait de triompher avec Banana Split, Francis Cabrel avait enfoncé le clou de la chanson romantique avec Je l’aime à mourir et Police nous proposait Walking on the moon.
Soudain, introduisant dans nos platines son Cheyenne Autumn, il nous était envoyé comme premier titre Les Animaux : une minute et quatre secondes de pluie, de cris de bécasses et de bruits d’étable d’où s’envolait le son d’un harmonica nostalgique. La note était donnée : pour suivre Murat, il faut oser porter des bottes boueuses et partir au fond des forêts.
pluie d’automne sur les hommes
comme Rhône à la Saône
tu te mêles à moi
des feuillages des ramages
dans ton ombre vagabondent
et l’automne est là
Jean-Louis Murat, Pluie d’automne, titre 4 de l’album Cheyenne autumn
les herbes se couvrent
d’automne
– je m’assieds
Matsuo Bashō [2]
Murat réitéra cet appel sur fond de pluie en ouvrant son second album avec le titre Animaluniquement composé de ce qui ressemble bien à un haïku :
Vois comme je vis mal
Je n’ai plus que toi
animal
Jean-Louis Murat, Animaluniquement
Murat, chanteur rural ou écolo ? Horreur et réduction ! On est bien plutôt là dans un lien fusionnel, enivré, émerveillé au vivant, dans son entièreté régénérante et fragile comme le perçoivent les poètes haïjins. [3]
Chats noirs, renards, insectes, rivières, neige, anémones ou genêts foisonnent dans ses paroles, et les écouter revenait souvent à pouvoir se reconnecter à un bestiaire et un lexique floral oubliés des pauvres citadins, pétrifiés alors dans des textes rocks pour la plupart de sensibilité post-industrielle.
En appui animiste chez le chanteur poète, bien sûr, le cycle des saisons, et même si Cheyenne Autumn et Le manteau de pluie sont plutôt de couleur automnale, souvent en mode mineur, quelques titres éclaboussent d’une fraicheur de printemps qui revient.
viens doux soleil
que tes rayons agitent autour de moi
ce monde d’abeilles
qui palpite impatient au fond des bois
Sors du long sommeil
les loutres endormies près des torrents
où luttent sans bruit
des poissons amoureux
dans le courant
Jean-Louis Murat, Cheyenne Autumn, titre 7 de l’album éponyme
Ce « commencement du commencement » a souvent saisi aussi le pèlerin- poète japonais :
mouvements
du cœur
dans le frisson du saule
Matsuo Bashō [4]
de quel arbre en fleur ?
je ne sais –
mais quel parfum !
Matsuo Bashō [5]
frémissement de feuilles et cris des troupeaux
Mais il y a plus que cette inspiration sensorielle : l’écriture même. Dans un entretien [6], au moment de la sortie de l’album Le manteau de pluie, Murat déclare : « Le haïku, c’est un repère […], ça oblige à faire concis. »
Lorsqu’on écoute ses deux premiers albums, aucun doute, l’artiste fuit le bavardage, le remplissage de refrains répétitifs, la glose. Il est alors en quête d’une écriture du silence. Mais un silence qui bruit de milles facettes : nappes atmosphériques, mots chuchotés – dont un magnifique enregistrement de la voix du réalisateur russe Tarkovski balbutiant le titre Nostalghia en fin de l’album Cheyenne autumn.
« Le premier mois à Pessade, je n’ai enregistré que du silence, a confié le chanteur. Je l’enregistrais de trois heures l’après-midi jusqu’à six heures, je mettais les enceintes dehors et le balançais à un autre moment. Jusqu’au moment où je me rends compte que le silence est une rumeur énorme. En le travaillant au sampler, il devient un cri d’enfant, un râle de mourant, un soupir de femme ou un train qui entre en gare. Ça me travaillait tellement que je l’ai fait sur ma voix. Je la samplais et j’en faisais du vent, des cris, un arbre qui tombe, tout. » [7]
le cri des cigales
vrille la roche –
quel silence !
Matsuo Bashō [8]
nuit d’été –
le bruit de mes socques
fait vibrer le silence
Matsuo Bashō [9]
Dans le silence des prairies ou des vallées, tant de bruits, effectivement ! Pas besoin d’en rajouter. Idem pour les textes : Murat préfèrera toujours, comme Bashō, saisir l’essentiel dans l’implicite et le non-dit, favoriser l’allusion. Et nous laisser chacun avec notre propre compréhension de ce qu’il raconte :
D’avoir mené les chevaux
D’avoir traversé les glaces
Pour me bâtir un troupeau
N’apaise pas mon angoisse
Pourtant le soleil est haut
Dans l’azur pas de menace
Je rêve parmi les chevaux
D’horizon mauve et d’espace
Jean-Louis Murat, Le troupeau, chanson 6 de l’album Cheyenne Autumn
l’âme wabi-sabi
La conscience de l’impermanence est aussi ce qui lie Murat à Bashō. Le chanteur pop sait, comme le moine-poète bouddhiste, que rien ne dure.
on se croit d’amour
on se sent épris d’éternité
mais revient toujours
le temps du lien défait
Et
Brume et pluie –
Fuji caché.
Mais cependant je vais content.
Jean-Louis Murat, Le lien défait, titre 4 de l’album Manteau de pluie
Une approche existentielle que Murat réitère trois chansons plus loin dans L’éphémère :
Tout est éphémère
La vie
La terre
Les choses vues
Qui nous ont plu
Les papillons
L’hiver, les loups, les cerfs
Je ne sais plus…
Dans les commencements, le poète ne peut s’empêcher de voir déjà la fin. Et vice-versa, ainsi que nous le suggèrent presque tous les haïkus de Bashō :
L’automne s’en va –
Une bogue de châtaigne fendue
Comme des mains entrouvertes
Matsuo Bashō [10]
le souffle des ancêtres
Ainsi le présent n’est jamais totalement vierge, pur. Il bruit de cette dynamique qui prend toute chose vivante. Et fait miroiter parfois dans l’instant les temps passés, ce que l’esthétique japonaise du wabi-sabi ne cesse de célébrer. Voilà sans doute le lien le plus serré entre Murat et Bashō : la patine du temps leur est délectable.
L’automne, les couleurs ternies, pleines de « ce qui s’est passé », les vieilles pierres, les chemins de terre, les cabanes au fond des bois, les calvaires pour l’un au dessus des ravines, les temples recouverts de mousse pour l’autre… Tel est leur paysage commun.
Mieux : leur terre natale vibre sans cesse du souffle des ancêtres ou de batailles anciennes. Bashō lorsqu’il traverse le Japon pour ses Journaux de voyage [11] le fait pour visiter les lieux historiques associés à la poésie, qui l’émeuvent souvent au point de verser des larmes. Par exemple, à Hiraizumi d’où il écrit : « C’est là que les hommes de Yoshitsune ont vaillamment résisté et se sont couverts de gloire au combat, mais cet instant est passé et leur gloire s’est transformée en herbe. Posant mon chapeau, j’ai oublié la fuite du temps, et j’ai pleuré. »
herbes de l’été
des valeureux guerriers
trace d’un songe
Tout comme ce Col de la Croix Morand, haut lieu du Puy de Dôme où Jean-Louis Murat entend encore la plainte d’un oublié. De cette légende, dont il tire une chanson. Il raconte dans une interview : « C’était en fait la Croix du Mourant au départ, car un type a été pris dans une tempête de neige là-haut et avait juré d’y dresser une croix s’il s’en sortait. Le col s’est longtemps appelé le col de la Croix du Mourant, puis la contraction s’est faite. J’aimais bien cette histoire. » [12]
Par mon âme et mon sang
Col de la Croix Morand
Je te garderai
Je te garderai
Pour ce monde oublié
Ce royaume enneigé
J’éprouve un sentiment profond
Un sentiment si lourd
Qu’il m’enterre mon amour
Je te garderai
Je te garderai
Jean-Louis Murat, Col de la Croix Morand
Entre le samouraï fondateur d’une poésie puissante et ramassée et le troubadour auvergnat capable, tel un chevalier, de chansons profondément habitées, tant de points communs ! Certes, Jean-Louis Murat n’a cessé de lire les poèmes courtois du 12e ou 13e siècle français, Madame Deshoulières (album éponyme en 2001), Dostoïevski (cf. son album Le Moujik et sa femme en 2002) ou Baudelaire (cf. son album Charles et Léo en 2007). Mais à Bashō et au haïku, il doit certainement d’avoir pu s’abreuver à une source aussi vivifiante que les eaux descendant des plus vieux volcans.
Merci aux fans de Jean-Louis Murat : Pierrot et son blog et Didier Lebras. Leurs informations et connaissances m’ont aidée dans la rédaction de cet article.
[1] Cent onze Haïkus, traduction Roger Sieffert
[2] Traduction de Zenu et Atlan, Gallimard 2002
[3] Les haïjins sont ceux qui écrivent des haïkus
[4] Anthologie Haïkus présentés et traduits par Roger Numier, editions Points Seuil
[5] Anthologie Haïkus présentés et traduits par Roger Numier, editions Points Seuil
[6] Pour Libération avec Laurent Rigoulet, en 1991
[7] Entretien avec Christian Fevret, les inrocks 1991
[8] Zenu et Atlan, Gallimard, 2002
[9] Zenu et Atlan, Gallimard, 2002
[10] Anthologie Haikus, présentés et traduits par Roger Numier, editions Points Seuil
[11] Cf. La sente étroite du bout du monde, traduit par René Sieffert dans son ouvrage intitulé Bashô. Journaux de voyage
[12] Interview Inrocks n°31
Vous avez aimé? Partagez et propagez un peu de poésie !

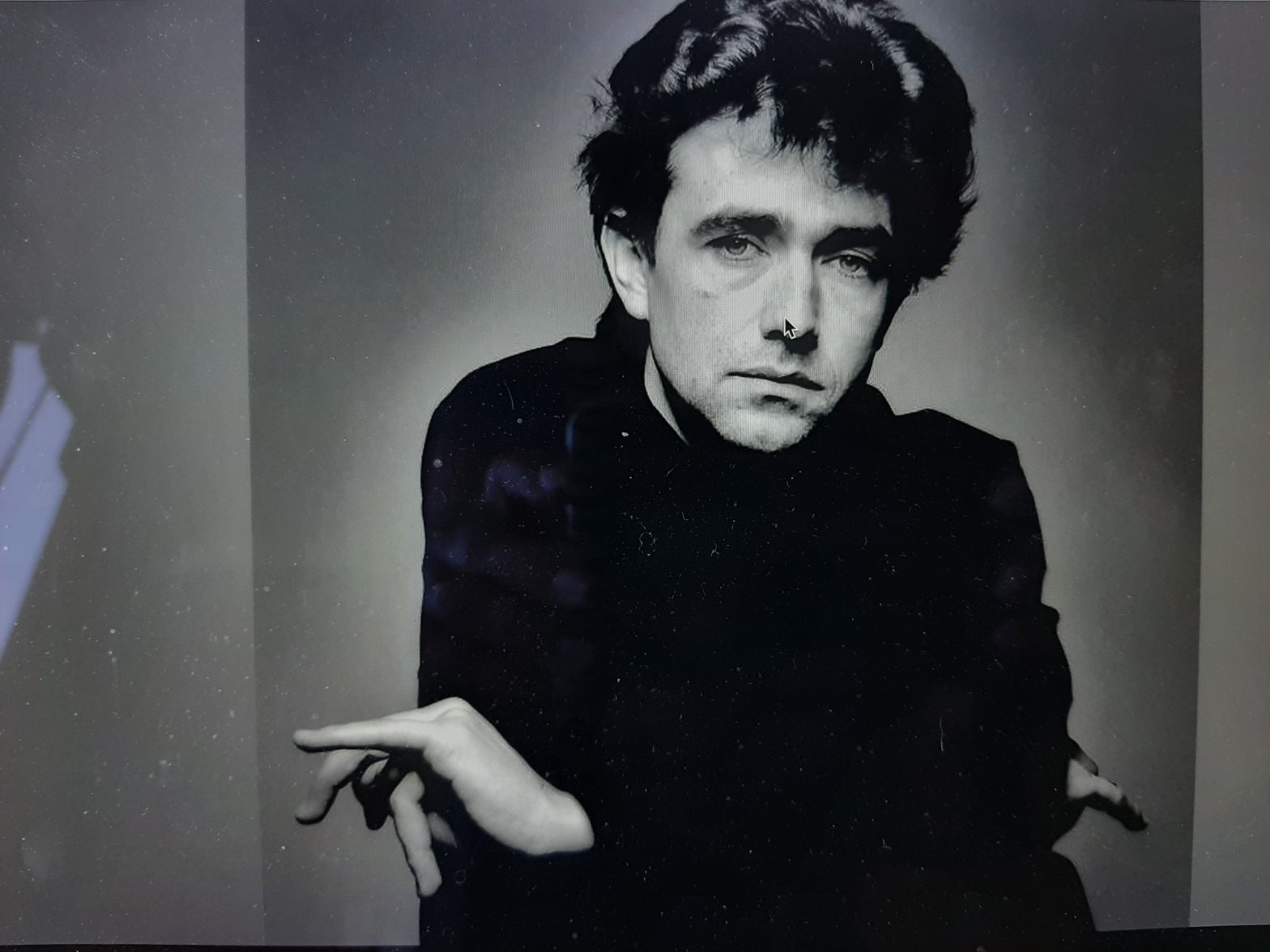
Quel article ! A lire et relire ! Merci Pascale !
merci à toi cher Haijin!
Depuis ses débuts , j’ai aimé la poésie de cet homme érudit, imprégné de cultures diverses et par trop méconnu.
Merci Pascale pour cette approche subtile en lien avec le haïku .
Merci chère Anne-marie. Un véritable auteur-poète, malheureusement capable d’auto-sabotage avec les années. Mais les deux premiers albums dont je parle ici sont des joyaux. Amitiés haijines à vous!