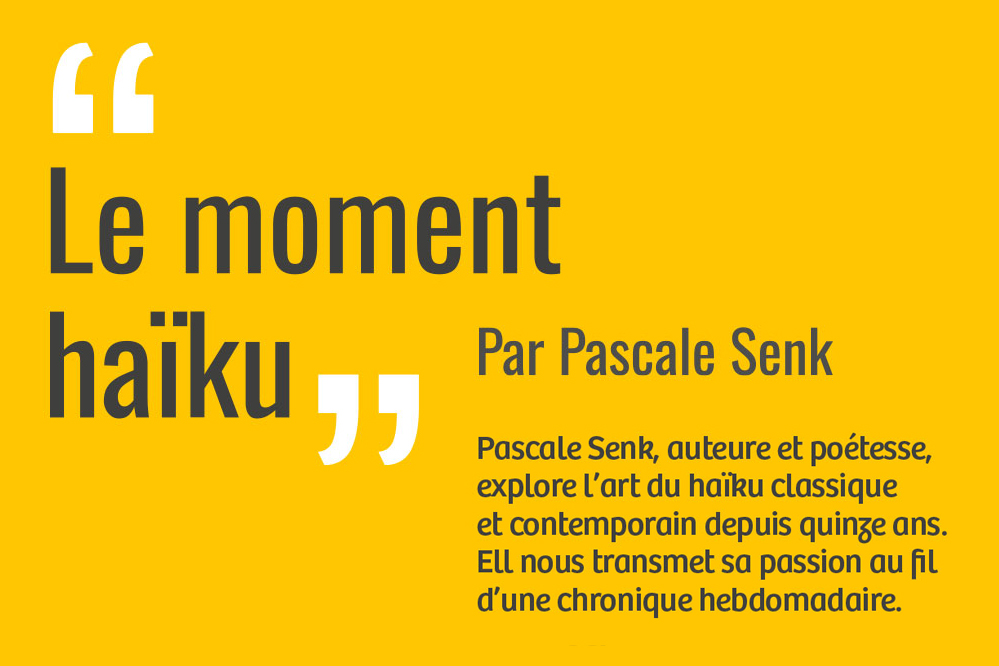Depuis juin 2025, j’écris une chronique hebdomadaire consacrée au poème bref, qu’il soit classique, contemporain, japonais ou de toute autre culture, dans strophe.fr, « le magazine de toutes les poésies ».
Une première pour le haïku !
Retrouvez les chroniques sur le site de strophe.fr ou bien ci-dessous.
strophe #1 – 03/06/2025
cerisier en fleurs
dans la cour de maternelle
je vole une branche
Éléonore Nickolay
Qu’elle est légère, agile, cette main chapardeuse ! À qui appartient-elle ? À une institutrice en mal de fantaisie ? À un élève turbulent des « grandes classes » ? À un parent d’élève qui vient célébrer ainsi la fin de l’année ? Peu importe. À travers ce geste, le haïjin — nom de celui qui écrit des haïkus — nous parle surtout de la part poétique en chacun de nous : celle qui déroge aux règles enfermantes, celle qui est capable de tout pour trouver un peu de beauté là où il en manque, celle qui vénère les pétales plus que l’or. Le poète cisèle là un haïku de printemps parfait : les cerisiers sont en fleurs bien sûr, mais aussi nous sommes dans un espace revitalisant (la cour d’école) près des plus petits des petits (les maternelles)… haïku de renouveau et d’enfance, donc, plein d’insouciance et de cette légèreté (karumi) que le maître du genre, Bashô (1649-1694), invoquait dans cette poésie qu’il a codifiée. Pas plus japonais que ce haïku donc, et pourtant on pense aussi à Prévert, Doisneau… l’esprit de liberté n’est-il pas universel ?
Éléonore Nickolay, Le pain surprise. Haikus, Association AFH
strophe #2 – 10/06/2025
Douce nuit de printemps –
une adolescente dit « bonsoir »
dans l’obscurité
Jack Kerouac
On pourrait être dans un film de David Lynch ou de Tarentino. Ce pourrait être aussi la première scène d’une pièce de Tennessee Williams. Normal, ce haïku est profondément trempé dans l’âme américaine, même si son auteur, l’écrivain poète beatnik Jack Kerouac (1922-1969), était d’origine franco-canadienne. Le climat qu’il nous offre ici, énigmatique et libertaire à souhait, est très représentatif de la manière dont les années 50 ont accueilli outre-Atlantique la poésie brève japonaise rencontrée lors des explorations du zen : avec respect, fascination et diligence. Kerouac affirmait vouloir garder le classicisme des codes japonais : la marque de saison (ici le printemps), la simplicité de la scène évoquée, l’amour de la nature… « Le haïku doit être très simple et libre de toute astuce poétique, faire une petite image et pourtant être aussi aérien et gracieux qu’une Pastorella de Vivaldi » disait-il. Oubliée en revanche la comptabilité en 5/7/5 syllabes, inutiles selon lui en langue anglaise, langue contractée et « toujours sur le point d’exploser ». Ici, tout le climat poétique naît de la marque de saison choisie en ligne 1. Imaginez celle-ci remplacée par « premiers grands froids » (haïku d’hiver) ou « nuit de canicule » (haïku d’été), l’irruption de cette adolescente dans le noir prendrait des couleurs totalement différentes. Avec la douceur printanière, Kerouac diffuse grâce, tendresse et spontanéité. On se demandera pendant longtemps où veut nous entraîner cette jeune fille sortie de nulle part.
Mild spring night –
a teenage girl said “Good evening”
in the dark.
Jack Kerouac, Le Livre des haïku, Éditions de la table ronde
Édition bilingue (français-anglais), préface et traduction par Bertrand Agostini
strophe #3 – 17/06/2025
Éventail cassé –
j’écoute le vent passer
entre mes doigts nus
Chiyo-ni
Aux premiers temps du haïku, peu de femmes japonaises ont fait entendre leur voix. Une poétesse, toutefois, Chiyo-ni, née en 1703 — soit 10 ans seulement après la mort du maître Bashô — a illuminé le petit format de sa magnificente féminité. Ce haïku est une illustration de ses qualités hors pair : présence, délicatesse et sensorialité. À travers cet objet on ne peut plus quotidien, ici abîmé (l’éventail cassé), débarrassé de toute préciosité, Chiyo-ni distille une sensation subtile : le toucher de doigts nus associé au souffle du vent ? Voilà une image synesthésique que notre Rimbaud aurait sans doute adoubée… Son haïku, ainsi traversé de brise, éloigne la lourdeur, les contraintes, l’empêchement. Tout le parcours de Chiyo-ni est d’ailleurs marqué par sa manière raffinée d’être libre : fille d’un imprimeur, elle rencontre très tôt poètes et calligraphes, s’initie au haïku à 16 ans, à la trentaine tient seule l’entreprise familiale, puis devient épouse, puis mère, puis veuve… Une existence déployée, avide de vivre. A cinquante-deux ans, elle prend refuge dans le zen et se choisit alors un nom de nonne qui sonne comme un manifeste poétique : soen, « jardin nu ». D’ailleurs, jusqu’à la fin de ses jours, elle composera des haïkus. Ses derniers notamment, patinés à la pratique régulière de la méditation, sont des joyaux d’épure et de conscience qui continuent de scintiller jusqu’à nous.
Chiyo-ni, Une femme éprise de poésie, Éditions Pippa, 2017
Traduction et présentation par Grace Keiko & Monique Leroux-Serres
strophe #4 – 24/06/2025
solstice d’été –
face aux vagues un enfant pointe
son colt à bulles
Pascale Senk
Pour une fois, un haïku de ma composition — et je m’y autoriserai de temps à autre. N’y voyez là aucune forfanterie, mais bien un usage de la poésie haïku : dans les recueils, le ou la haïjin publie rarement ses poèmes brefs seuls. Ceux-ci sont souvent accompagnés en amont d’un commentaire (kotobagaki) visant à préciser l’anecdote, l’inspiration, l’émotion ayant suscité l’envie d’écrire… Le titre du commentaire de celui-ci pourrait être : « pas de lumière sans ombre ». Imaginez une situation à priori idéale, face à la Méditerranée et sous un ciel limpide. Nous sommes au zénith, la lumière emporte tout. Sur cette plage, je me trouve à contempler pendant de longues minutes les mouvements erratiques, au bord du sable, d’un garçonnet joyeux, tout plongé dans son jeu, ses ennemis imaginaires, sa guerre enfantine. Mais dans un coin de ma tête, une ombre s’immisce. Le contexte international dont j’ai perçu les échos à la radio le matin même empêche le calme de mon esprit : le monde s’embrase et notre impuissance s’accroît chaque jour. Comment ne pas y penser ? Soudain, je réalise : le petit projette quelques bulles d’eau contre les rouleaux menaçants qui avancent sur le bord. Geste inutile et don quichottesque ! Sa fragilité m’envahit. La sienne ? La mienne ? La nôtre ? La scène, mi-ludique, mi-tragique, me bouscule. Elle mérite un poème. Je saisis alors mon carnet. Ainsi naissent les haïkus : dans des moments d’entre-deux existentiels qui imposent l’indicible.
strophe #5 – 01/07/2025
Délice
de traverser la rivière d’été
sandales en mains !
Buson
Certains haïkus vous marquent plus que d’autres. Soit parce qu’ils surgissent à un moment de votre vie qui entre en totale résonance avec eux, soit parce qu’ils vous ouvrent à des sensations oubliées. Celui-ci appartient à la deuxième catégorie : depuis le début, il sonne en moi comme un bain de jouvence et éclabousse de fraîcheur la pire de mes journées. Je le lis et le relis comme un glaçon que je poserais sur ma joue. Composé d’une seule image qu’il déroule sur les 3 lignes (une figure de style appelée ichibutsu jitate), il évoque une situation commune, banale, mais ici saisie de l’intérieur. Dans leur implicite, les pieds touchés par l’eau fraîche emportent tout ! Et puis il y a cette « rivière d’été », qui nous chante les pierres glissantes, le courant ralenti, le bruissement amplifié des insectes. Buson (1716–1784), grand maître du haïku classique, utilise plusieurs fois cette formule dans ses poèmes. Elle est l’alliée au bout de chemin, le refuge rafraîchissant, la possibilité retrouvée d’un contact fusionnel avec le vivant. Elle offre l’escapade où peuvent aussi, en ce moment fugace, s’arrêter nos pensées. Que demander de plus en ces temps de canicule ?
Corinne Atlan et Zéno Bianu, Haïkus, Collection Folio/Bilingue, 2022
strophe #6 – 08/07/2025
Ce matin beau temps sur le golfe
Je suis resté immobile
À penser à l’absent
Roland Barthes
Voici un haïku pataud et, osons le dire, raté : il consiste en une phrase pliée, excède dix-sept syllabes (le format maximum requis), fait référence à un temps passé (alors que le haïku cherche à capter un instant présent)… Bref, ce n’est pas vraiment un haïku. Et pourtant, combien il nous touche ! Car son auteur, Roland Barthes, est sans doute l’intellectuel qui a fait le plus pour faire connaître cette poésie brève en France. Il lui consacre un cours au Collège de France (en 1978), différents articles de L’empire des signes, son essai le plus connu sur la sémiologie japonaise, et enfin, dans son best-seller Fragments d’un discours amoureux, se lance et tente d’écrire ses sentiments en haïku. N’a-t-il pas prévenu : « C’est une forme pour laquelle j’ai une admiration profonde, c’est-à-dire un désir profond. »
Premier essai :
Ce matin d’été beau temps sur le golfe
Je suis sorti
Cueillir une glycine
Où sont passées la mélancolie et l’obsession amoureuses que l’auteur souhaitait exprimer ? Barthes, frustré, tente un autre haïku, trop banal selon lui. Puis ce dernier, présenté ici. Pour lui, un nouvel échec. Ainsi, le vénéré théoricien de l’écriture jette les armes : en matière amoureuse, ses haïkus lui échappent : « D’un côté, c’est ne rien dire ; de l’autre, c’est dire trop. Impossible d’ajuster. » À travers cette expérience, Barthes montre pourtant l’ADN de cet art poétique qui le subjuguait : l’humilité, la réécriture, la subtilité de l’indirect.
Roland Barthes, Fragments d’un discours amoureux, Éditions Points
strophe #7 – 15/07/2025
rotation des serviettes
les corps tournesols
suivent le soleil
Philippe Macé
Pour le ou la haïjin — celui ou celle qui écrit des haïkus — une journée à la plage peut devenir un voyage intergalactique. Dans cette parenthèse balnéaire, il y a chez nos contemporains tant de bizarreries à observer ! Du tendre, du surprenant, du grotesque… En cette matière, l’auteur du haïku présenté ici est passé maître. Dans son recueil Vieux plongeoir, bruit tout le petit monde des congés payés qu’il retrouve chaque année à Arcachon : l’ado qui s’ennuie sur le sable, la grosse dame qui court après son parasol, les gestes élégants qui retiennent les chapeaux… Chaque haïku semble alors tout droit sorti d’un film de Jacques Tati :
maillot deux-pièces
la sœur ainée
fait sa grande
Quand les haïkus sont ainsi caustiques, propres à pointer les petitesses de notre condition humaine, à rire de nos comportements, on les nomme senryus. Dès les premières heures de cette poésie, les japonais en raffolaient, car la moquerie douce, l’esprit critique respectueux étaient l’un de leurs codes fondateurs.
Par rapport au haïku, cependant, le senryu est achevé. Son sens se résout en lui-même, il n’ouvre pas à mille questions ou interprétations chez son auditeur/lecteur. Son but, son inspiration et son effet n’ont qu’un point d’appui : l’humour face à la faiblesse humaine. Celui-ci est tellement nécessaire !
Philippe Macé, Vieux Plongeoir, haïkus et senryus de vacances, Éditions Pippa
strophe #8 – 22/07/2025
Silence –
le cri des cigales
taraude les roches
Bashô
Comment, avec des mots, dire le silence ? Comment avec une image sonore, dire la chaleur ? Peut-être Bashô (1649-1694), LE maître des haïkus, s’est-il posé ces questions avant de composer ce joyau d’été qui traverse la nuit des temps, et notamment grâce aux différents traducteurs — plus d’une dizaine — qui se sont essayés à le restituer en français. On mesure la difficulté et l’importance de leur travail dans cet art poétique ciselé. Car même si l’on ne connaît pas la langue d’origine, il se trouve qu’en poésie, une traduction vous touche, ou pas. Avant de choisir celle-ci, de l’immense critique et écrivain Roger Munier qui, en 1978, présenta sans doute la meilleure anthologie de haïkus classiques, il y eu la traduction de Georges Bonneau, en 1935 :
Calme immense.
Seul, pénétrant les rocs,
Le cri des cigales !
Ou, en 1984, celle de René Sieffert :
Ah le silence
Et vrillant le roc
Le cri des cigales
Et bien d’autres depuis… On le voit : dans la dentelle de la poésie haïku, il suffit de l’utilisation des majuscules, ou d’une virgule, d’une interversion de ligne, pour créer une tout autre ambiance, un tout autre point de vue. Et toucher différemment le lecteur qui, avec l’expérience, saura élire son traducteur de choix. Et vous, quelle version préférez-vous ?
strophe #9 – 29/07/2025
cité dortoir –
les ronflements du voisin
dans mon salon
Ben Coudert
Que ceux qui pensent que la poésie haïku ne s’intéresse qu’aux cerisiers en fleurs et aux divers enchantements de la nature passent leur chemin I Certes, une grande part des poèmes brefs sont contemplatifs et émerveillés. Mais beaucoup, appelés alors des senryus, (voir notre chronique #7) dénoncent les vicissitudes et travers de notre condition humaine. C’est le cas des haïkus de banlieue de Ben Coudert, disquaire et musicien de profession qui, dans des recueils percutants, raconte sa vie à Vitry-sur-Seine, entre RER bondés et murs graffités. On y croise des rames surchauffées, du béton à tout va, et de l’herbe seulement à fumer… On rit, on grince des dents, on se dit « Non, celle-là il ne va pas la faire ? » Et il la fait.
soirée Karaoké
John Lennon assassiné
une seconde fois
Qui voudrait réaliser un documentaire sur la condition banlieusarde aujourd’hui y trouverait moult informations. Mais si ces haïkus parviennent réellement à nous toucher, c’est aussi parce qu’au cynisme y sont toujours mêlées tendresse et fine compassion, valeurs codifiées et invitées dès le début de cet art poétique.
banlieue anonyme
derrière chaque fenêtre
l’histoire de quelqu’un
strophe #10 – 05/08/2025
La foule des nuages
Cimes et ravins d’été
Puissé-je y mourir
Lida Dakotsu
Il peut sembler étrange de parler de nuages en été. Le ciel alors n’est-il pas le plus souvent limpide, azuréen ? Et bien non ! Si vous levez les yeux en ces temps chauds, vous découvrirez la vie contrastée et inspirante des « nuages d’été ». Ainsi, Alain Kervern, éminent traducteur du Grand almanach poétique japonais qui recense les multiples marques de chaque saison inspirant la poésie haïku (kigos), nous apprenons par exemple à reconnaître les caractéristiques des cumulo-nimbus du mois d’août, ces masses à « l’allure tourmentée », aux volutes blanches qui « font contraste avec l’azur ».
Sommeil d’été
Sur mes genoux
Les blancs édredons des nuages
ISSA
Ces géants vaporeux du ciel n’ont rien à voir avec les bancs de « nuages-sardines » qui tapissent d’un poing serré le ciel d’automne, ou les nuages froids et comme pesants de métal gris qui reviennent parfois au printemps, au moment même où on les avait oubliés… Comme il y a une science des feuilles, des lunaisons ou des différentes pluies, il y a ainsi toute une science des nuages chez les poètes haïkistes. Car ceux-ci écrivent à partir de leur observation du vivant, quelles qu’en soient ses formes, et toujours en lien avec le cycle des saisons, toujours si poétique. À la manière de Baudelaire, dans ses Petits poèmes en prose, si on les questionnait, sans doute répondraient-ils :
« — Eh ! qu’aimes-tu donc, extraordinaire étranger ?
— J’aime les nuages… les nuages qui passent… là-bas… là-bas… les merveilleux nuages ! »
Alain Kervern, La Tisserande et le Bouvier. Grand almanach japonais Livre III, Éditions Folle Avoine
strophe #11 – 12/08/2025
l’ombra di a noce
fiurisce in cor’ d’estate
ci possu nudà
Flavia Mazelin Salvi
Oui, c’est un haïku en langue corse ! Il nous dit :
l’ombre du noyer
fleurit au cœur de l’été
je peux y nager
Son auteure a rassemblé dans ce beau livre, avec le désordre du cœur, des recettes de cuisine — celles des ficatelli ou des frappe — des photos de son village de Francardo ou du missel de sa grand-mère Ernestine, des broderies, des dictons familiaux… et des haïkus qui, en point d’orgue, viennent scander son voyage intime dans la mémoire et les sensations. On voyage dans une enfance, une culture, une âme nourrie de saveurs. Car la nanopoésie, à travers ses petites madeleines en 3 lignes, a effectivement ce pouvoir d’encapsuler non seulement le présent, mais aussi les souvenirs. Porteurs d’impermanence, les haïkus diffusent le nagori, cette empreinte indéfectible d’une chose qui a passé, et qui continue à nous habiter. Le choix de la langue corse, langue maternelle, est ici un second point d’ancrage pour tenter de garder un peu de ce qui s’en est allé. Une occasion pour nous de rappeler aussi que désormais, la poésie haïku s’exprime dans toutes les langues du monde : roumain, finlandais, et même touareg… Si le Japon reste la source, point besoin d’être japonais pour écrire des haïkus, pour peu qu’on étudie et revienne régulièrement à sa source nippone.
Flavia Mazelin Salvi, Francardo Nagori, Éditions Punto e basta
strophe #12 – 19/08/2025
nous nous embrassons –
les tournesols
se détournent
Madoka Mayuzumi
L’œil des fleurs de soleil, leur vibration dans l’air chaud, le vertige d’un baiser peut-être longtemps retenu, l’érotisme quasi imperceptible des choses vivantes… En quelques mots, ce haïku nous plonge dans l’âme de l’été. Et la poétesse Madoka Mayuzumi — sans doute la haïjine contemporaine la plus en vogue au Japon — nous offre paradoxalement, avec tant de porosité sensible au réel, un haïku presque surréaliste. Car, bien sûr, les tournesols ne savent rien de notre vie amoureuse ! Mais, dans cette poésie, le lien à la nature est si ténu, si fusionnel, si déterminant, qu’il emporte tout sur son passage… et nous convainc que nos cœurs sont en résonance, oui, en résonance, avec les végétaux, les animaux, les astres, les saisons…Dans son magnifique recueil, Madoka Mayuzumi commente l’anecdote : effectivement, un couple d’amoureux s’était isolé de son groupe d’amis pour se cacher parmi les tournesols. « Ce haïku décrit le léger sentiment de honte qu’éprouve en secret la jeune fille, malgré l’exaltation provoquée par le baiser échangé. » Certes. Et Corinne Atlan, traductrice, nous rappelle l’extrême pudeur amoureuse dans la poésie japonaise — hormis pour les haïkus grivois, un genre à part. Là où nos troubadours et autres Romantiques ont écrit des millions de vers tous tendus vers l’amour, les haïkus qui évoquent même un baiser sont excessivement rares. Est-ce pour cela qu’ils nous troublent tant ?
strophe #13 – 26/08/2025
Nu
sur un cheval nu
à travers l’averse!
Kobayashi Issa
Vous vous sentez à l’étroit ? L’idée seule de « rentrée » vous pèse ? Voilà un haïku qui décoiffe. Sa force sensorielle a traversé les siècles sans ombrage : sensualité de la peau des cuisses à vif sur une monture sans selle, gouttes d’eau à regarder couler sur les corps sans protection — animal et homme —, vitesse du galop… Pour peu qu’on cherche à visualiser une image de liberté totale, sauvage, en pleine nature, celui-ci répond à l’appel !
Ce haïku détonne d’autant plus que son auteur, Kobayashi Issa (1763-1827), est plutôt connu pour une poésie toute en délicatesse et apaisement. D’ailleurs, son nom de plume (Issa signifiant « bulle d’eau sur une tasse de thé ») annonçait ce programme de douceur. Il a laissé plus de trois cents haïkus sur les chats, en a écrit de nombreux autour du deuil — notamment après la mort de sa petite fille Sato, alors âgée de moins de deux ans —, et a livré des joyaux existentiels sur la dureté du destin…
Et là, tout à coup, cette image puissante et radicale nous évoque une âme punk totalement déliée. Mais d’ailleurs, de qui parle ce haïku ? De l’auteur, Issa ? D’un autre qu’il contemple sur sa monture ? D’une virée en ville ? D’une cavalcade en pleine steppe ? Comme les meilleurs d’entre eux, ce haïku laisse place à toutes sortes d’interprétations.
Seule certitude : lorsque le ciel est morne et la fin d’été déprimante, le lire est comme un coup de fouet revigorant.
In « Haïkus de printemps et d’été », Folio Gallimard, trad. Corinne Atlan et Zéno Bianu
https://www.fnac.com/a15510088/Collectif-Haikus-
strophe #14 – 02/09/2025
A la porte d’entrée
L’Etranger se tient debout
Entrée dans l’automne
Yasushi Nozu
Même si l’équinoxe « officiel » n’arrive que dans deux semaines, la sensation d’automne, en de nombreux endroits, est déjà là. Inquiétudes de la rentrée, inconnu à venir, longues nuits annoncées… C’est tout cela que nous évoque ce haïku de Yasushi Nozu, poète expert dans le nuancier subtil des saisons.
Celui-ci est en effet directeur de publication d’un almanach poétique de saison franco-japonais qui rassemble les marques saisonnières (kigos) au cœur de l’écriture de haïkus. Cet ouvrage, qui vient d’être publié en France, est une mine d’informations prêtes à se transformer en saveurs poétiques.
Il faut savoir que, dans leur pays, dès les petites classes, les Japonais sont formés à reconnaître et à trouver ces indications subtiles des métamorphoses de la nature : les feuilles qui sèchent, ou la jonquille qui apparaît, la lumière qui s’allonge… Le monde vivant est alors comme un ami dont les messages sont à écouter et contempler.
Un art qui fait l’un des charmes majeurs de cette écriture. Particulièrement inspirantes, ces périodes d’effacement d’un climat, annoncées par les prémices d’une nouvelle saison. On ne se lasse pas de ces « entre-deux », si fertiles en sentiments subtils. Même lorsqu’il s’agit, comble de tout, de dire adieu à la lumière d’été.
Saijiki francophone, sous la direction de Yasushi Nozu, éditions Unicité, 2025
strophe #15 – 09/09/2025
Café en terrasse
je tourne le ciel
dans ma tasse
Pascale Dehoux
Saisir le bonheur avant qu’il ne se sauve ?
Les haïkus les plus réussis, comme celui-ci, parviennent à « encapsuler » les moments précieux en en préservant le mystère, l’impromptu, l’incontrôlable. Ainsi, nous voici frappés par sa banalité soudain vertigineuse.
Nous sommes là, attablé·e dehors, bien présent·e, et en même temps ailleurs…
Les propos de notre interlocuteur — s’il y en a un — nous parviennent de loin, comme tamisés par la lumière venant caresser notre visage, et dont nous ne voulons pas rater une miette…
Combien de fois avons-nous cherché à goûter au plus près ces temps de relâchement, quand le soleil traîne encore un peu dans les rues affairées ? En septembre, plus que jamais, nous souhaitons profiter de ces cadeaux de l’arrière-saison. Et prolonger les minutes de farniente qui vont, c’est certain, venir à se raréfier.
Dans le recueil de la poétesse Pascale Dehoux, joliment titré Les heures lentes, nous sommes ainsi invités à changer de rythme et à contempler la vie dans son essence passante.
Sieste
Une feuille en tombant
emporte le silence
La bonne nouvelle, c’est que la lecture de ces poèmes devient alors pure méditation. Et que nous pouvons, grâce à elle, nous promener en toute liberté, délestés des préoccupations bruyantes de la réalité qui nous entoure.
📖 Les heures lentes — Pascale Dehoux (via-domitia.fr)
strophe #16 – 16/09/2025
le voleur
a tout pris
sauf la lune à la fenêtre
Ryokan
Du point de vue des astres, ce mois de septembre a tout pour nous agiter. Imaginez : une pleine lune avec éclipse totale le 7, une nouvelle le 21, un équinoxe (d’automne) le 22…. De quoi nous rendre « lunatics »comme disent nos amis anglophones…ou poètes ! Du côté des haïjin.e.s – ceux qui écrivent des haïkus- ce choix a été fait depuis la nuit des temps. La lune leur est une source d’inspiration majeure. Bashô (1649-1694) par exemple, était prêt à parcourir des centaines de kilomètres à pied pour aller contempler les reflets de « la lune de l’Ouest » ainsi qu’il le raconte dans ses journaux de voyage, dont La Sente étroite du bout du monde
“Voici une lune semblable à celle que contemplaient les anciens. Elle éclaire les mêmes montagnes, le même vent souffle dans les pins. Et pourtant, tout a changé. Le monde s’efface sous sa lumière. Même mon propre cœur devient passager.
Cette nuit-là, j’écrivis :
Lune de montagne —
mon cœur aussi
s’élève et s’éloigne”
Bashô
Difficile donc, voire impossible de choisir parmi ces joyaux que sont les haïkus lunaires. Dans celui-ci, Ryōkan (1758-1831), ermite qui ne possédait qu’une cabane de chaume, y raconte un évènement réel : une nuit, on l’a dépouillé de ses pauvres possessions. L’occasion pour lui de rappeler un socle de la tradition zen : quand il ne nous reste rien, il nous reste encore le ciel, les arbres, la montagne, …et la lune ! Que demander de plus ?
Ryokan, recueil de l’ermitage au toit de chaume,Ed Moundarren, 1994
strophe #17 – 23/09/2025
Feuilles d’or pourrissantes,
Avec sur elles une odeur
De mort et d’espoir
Richard Wright
Comment dire en un minimum de mots la radicalité de l’existence, sa beauté parfois, sa raideur souvent ? C’est un défi auquel l’écrivain afro-américain Richard Wright (1908-1960) répondit durant les derniers mois de sa vie à travers la composition de plus de 4 000 haïkus.
Lui, le romancier prolifique, le militant, l’habitué des narrations longues (son grand roman Black Boy, œuvre majeure du panthéon littéraire anglophone, atteint les 450 pages). À l’époque de sa « haïku-mania », il est en exil à Paris, se remet d’une sévère dysenterie amibienne et de plusieurs deuils affligeants, et il peine à corriger son dernier manuscrit.
Je ne suis personne :
Un soleil couchant d’automne
M’a laissé sans nom
Sa fille Julia Wright, dans sa préface du recueil post-mortem qui naquit de cette phase créative, estime avec le recul que, pour son père, « ses haïkus étaient des antidotes qu’il se prescrivait à lui-même pour surmonter la maladie et que la décomposition syllabique des mots faisait écho à son souffle saccadé ».
Restent publiés de cette plongée poétique époustouflante 817 haïkus que nous pouvons désormais déguster en version bilingue. Capables de tisser le pire et le meilleur, la tendresse et la colère, ils ont un goût puissant : celui de l’ambivalence humaine.
📖 Référence
Richard Wright, Haïkus, édition bilingue, La Table Ronde, 2009.
strophe #18 – 30/09/2025
Saison des labours
l’homme qui cherchait son chemin
se perd dans le lointain
Buson
Souvent, pour leur capacité à saisir l’instant fugace, les haïkus sont comparés à des photographies. S’il est juste, ce rapprochement mérite d’être complété : photographique, l’écriture du haïku l’est notamment quand elle parvient à restituer dans l’image composée un effet de « zooming ». Ce haïku de Buson, par exemple, élargit le champ (zoom-out) avec brio. Celui qui était au premier plan, voyageur inconnu, devient une silhouette au loin et, en l’effaçant ainsi, du plus près jusqu’à l’horizon, le poète approfondit un mystère. On pense à un film d’Andreï Tarkovski, avec ses longs plans sur la terre ; on pense aux landes brumeuses d’Ecosse ; on pense à l’évanescent.
Parfois, dans d’autres haïkus, le haïjin – celui qui écrit des haïkus- cherche à focaliser l’attention sur le plus petit, le « micro » (zoom-in):
Sur la pointe d’une herbe
devant l’infini du ciel
une fourmi
Hosaï
Ici, il joue du contraste entre l’infiniment petit (la pointe d’une herbe, c’est encore moins qu’une herbe !) et l’immense (le ciel, mais en plus dans son « infini » !).
Cet art du cadrage est l’un des plus grands défis de la poésie brève qui parvient, malgré ses contraintes formelles (ou grâce à elles ?) à offrir vraiment …un autre point de vue.
Bashô, Issa, Shiki…L’art du Haïku, préfacé par Pascale Senk et présenté et traduit par Vincent Brochard, Livre de Poche, 2010
strophe #19 – 07/10/2025
tramway –
la petite sourit à la foule
des smartphones
Coralie Creuzet
Bien sûr, il y a la poésie de combat — militante, indignée, révoltée.
Éluard et Aragon, dans notre histoire. Les poètes d’Ukraine ou de Palestine, aujourd’hui.
Eux sont armés, le plus souvent, de vers longs et multiples, qui viennent scander avec colère leur dénonciation de la violence humaine.
Et puis, il y a le haïku, qui travaille la question politique — au sens originel de « la vie dans la cité » — de façon bien plus discrète, en retrait, mais non moins pertinente. Lui cherche l’éclat furtif plutôt que le tir d’obus.
Engagés, les haïkus de Coralie Creuzet, comme celui-ci, le sont à coup sûr.
Mais s’ils le sont, c’est sans nous expliquer comment il faut penser, car dans la poésie haïku il s’agit avant tout de montrer.
Pour dénoncer la froideur technologique de notre monde : montrer la solitude de l’enfant en quête d’attention.
Pour rappeler l’humanité des populations en exil : évoquer leur cœur.
retour des hirondelles —
un jeune migrant
me parle d’amour
C’est ainsi qu’au Japon, les haïkus envoyés aujourd’hui par les lecteurs aux organes de presse nationaux (Mainichi Shimbun et Tokyo Shimbun, notamment) sont des témoins précieux de résilience, de mémoire ou d’engagement écologique.
Des plates-formes digitales collaboratives invitent aussi les internautes à poster leurs poèmes brefs d’actualité.
Respectant l’esprit de résistance discrète de cette poésie, les haïjins contemporains y dénoncent la solitude, ou la politique des gouvernements… mais toujours en dix-sept syllabes maximum.
Et comme souvent, c’est le silence qui les entoure qui résonne le plus fort.
Les Bleus du papillon, Coralie Creuzet, éditions Via Domitia
strophe #20 – 14/10/2025
les herbes se couvrent
d’automne
je m’assieds
Bashô
Il peut sembler étrange de choisir ce haïku pour évoquer l’un des plus grands écrivains-marcheurs de tous les temps, Matsuô Bashô. Car cet immense poète, sorte de « Victor Hugo nippon », est ici méditatif, à l’arrêt, tout entier pris dans l’ici et maintenant vanté dans la tradition zen… et assis.
Il vient de parcourir plus de cent cinquante jours de marche, près de deux mille kilomètres, qui l’ont mené d’Edo – l’actuelle Tokyo – jusqu’aux régions du Nord du Japon. On imagine la dureté d’un tel périple en 1689, dans un archipel féodal !
Cette aventure hors normes, il la raconte dans sept journaux de voyage, et notamment La sente étroite du bout du monde, dans laquelle il entrelace, en prose et en haïkus, des « choses vues », des anecdotes et des rencontres sur le chemin, des joies et des épreuves de pèlerin…
Ce haïku – ici dans sa première traduction française (Bonneau, 1935), la plus épurée – claque comme un joyau de fusion entre l’homme et le vivant. Bashô est sur le « retour », à tous les sens du terme, dans sa dernière étape vers Ōgaki, la ville où s’achèvera son voyage.
Il a célébré la fin de celui-ci avec d’autres marcheurs et poètes ; il est à la fois heureux de cette soirée, d’avoir accompli ce défi, et mélancolique… car il est à l’automne de sa vie aussi, et peut-être pressent-il déjà que sa mort est proche.
Alors, dans une acceptation à la fois spirituelle et physique, il peut s’asseoir, comme pour se fondre dans la nature – elle qui, après son passage, ne cessera de se transformer.
strophe #21 – 21/10/2025
oisive et seule
le délicat parfum d’herbe
de mon thé Sencha
Cristiane Ourliac
Les buveurs de thé et les poètes haïkistes ont en commun l’amour de la pause — mais pas seulement : ils partagent le goût de l’infusion subtile, des végétaux libérant des sucs profonds, propres à leur terre et à leur saison d’origine.
Thés d’ombre et Oolong chinois à déguster en automne, matcha crémeux utilisé pour la cérémonie zen… Ici, la haïjine Cristiane Ourliac, artiste et poétesse vivant à Montreuil, savoure probablement un thé de printemps, qui l’accompagne et l’inspire dans une solitude appréciée.
Quand la haïku-dō, voie du haïku, rejoint la cha-dō, voie du thé — qui est connaissance fine et présence —, cela peut donner un recueil aux saveurs profondes, comme son Thé de troisième eau, l’un des élus de l’Association francophone de haïku.
pénombre automnale
le bruit de l’eau qui bout
et la pluie en pointillés
Dès leurs premiers pèlerinages au fin fond du Japon, les maîtres du haïku furent inspirés par l’infusion des feuilles de théier, au point de la célébrer dans de nombreux poèmes : leurs mains entourant un bol brûlant, l’intensité du breuvage noir au petit matin… Ils adoraient cela ! Issa, pour viser la légèreté poétique, avait même choisi ce nom de plume signifiant « bulle d’air dans une tasse de thé ».
Nourrie de culture chinoise, la poésie haïku s’appuie elle aussi sur la vérité énoncée par Lu Yu : « On boit le thé pour oublier le bruit du monde. »
Cristiane Ourliac, Thé de troisième eau, coll. Solstice, Association francophone de haïku — Boutique
strophe #22 – 28/10/2025
coucou
conduis-moi là où
les nuages dérivent
Uko
« Memento mori » : s’il est un message que nous chuchote l’automne, c’est bien celui-là : « souviens-toi que tu vas mourir ». Les couleurs brunissantes de ce qui a été vert, la danse des feuilles vers la terre et, après Halloween, nos fêtes aux disparus… Comment oublier notre condition? Dans la poésie haïku, non seulement on s’en rappelle chaque jour, mais on en vient même à s’y préparer. Notamment, en composant son dernier haïku, l’ultime, appelé jisei . Ce dernier message qui devait célébrer leur départ, certains poètes l’ont écrit et retravaillé toute leur vie ! Dans son beau livre consacré à ces poèmes d’adieu, Pierre Reboul, qui œuvre lui-même dans l’accompagnement à la fin de vie, plonge dans la variété inspirante de ces haïkus précieux : certains sont de gratitude pour la vie qui a été offerte ; d’autres visent à l’acceptation, d’autres encore voient devant eux un voyage enviable…
enfant du chemin,
je pars enfin…
un saule sur l’autre rive
Benseki
Toute cette palette de sentiments et d’images sont autant de manières poétiques de pouvoir penser l’impensable, sa propre mort ! Si le coucou invoqué dans ce jisei d’Uko est toujours annonciateur du trépas, bien d’autres symboles sont souvent convoqués : la gloire-du-matin qui s’ouvre à l’aube et se fane dans l’après-midi du même jour, les lucioles incandescantes, le chant des cigales martelant la brièveté de la vie…Toute une symphonie d’autant plus vibrante qu’elle nous parle avant tout de…silence.
Pierre Reboul, Haïkus du seuil de la mort, éd. Le Prunier-Sully
strophe #23 – 04/11/2025
sur le rebord
de mon esprit
un moineau se pose
Soizic Michelot
Certains haïkus, comme celui-ci, sont pleins d’attention, de calme et de compassion. Normal : ils sont pleins de zen. N’oublions pas en effet que le berceau de leur naissance, le Japon à partir du XVIIe siècle, était irrigué de shintoïsme, de taoïsme mais surtout de bouddhisme. D’une certaine manière, la poésie haïku est le versant littéraire de cette philosophie, dont les meilleurs contemporains sont encore vibrants. Soizic Michelot, méditante émerite et enseignante de pleine conscience, vit cette fusion dans son écriture. Les liens entre sa poésie et l’entrainement de son esprit à l’observation des pensées sont si ténus qu’au fond on ne sait pas vraiment les démêler …
ma propre buée
à la fenêtre
je suis en vie
Dégustant son recueil, quelques questions nous arrêtent, tout comme elles le font lorsque nous lisons les maîtres classiques : qui du haïku ou de la méditation donne naissance à l’autre ? Est-ce le poème qui est socle de méditation ou la méditation qui inspire l’écriture du poème ? Après tout peu importe puisque dans un cas comme dans l’autre seule la présence doit l’emporter. Et les mêmes traits d’esprit semblent réunis chez le poète haïkiste et le moine zen : parmi eux, l’acceptation reconnaissante, l’humour, la solitude, la non-intellectualité, la contradiction…autant de sources qui, indirectement, viennent aussi nourrir le lecteur.
Soizic Michelot, haiku-petits-chants-de-la-pluie-et-du-beau-temps/
éd La Part commune
strophe #24 – 11/11/2025
L’obus en éclats
Fait jaillir du bouquet d’arbres
Un cercle d’oiseaux.
Georges Sabiron
En cette semaine de tristes commémorations, il est troublant de penser que la plus légère des formes poétiques, le haïku, a germé chez nous dans des tranchées : celles de la Grande Guerre, vaste boucherie qui emporta près de neuf cents jeunes Français chaque jour.
Parmi eux, Georges Sabiron, homme de lettres et collaborateur de revues comme Mercure de France ou La Vie… Il trouva la mort en 1918, sur un champ de bataille dans l’Aisne, mais eut le temps de laisser de lui quelques haïkus qui demeurent comme des éclairs ramenés de l’horreur.
D’autres jeunes soldats ont ainsi témoigné en poèmes brefs. Le plus connu reste Julien Vocance, qui publia ses Visions de guerre dès 1916, et eut la chance de survivre au pire.
Des croix de bois blanc
Surgissent du sol,
Chaque jour, çà et là.
Julien Vocance
Ces jeunes hommes sont alors imprégnés du japonisme qui a fleuri en France depuis la fin du XIXᵉ siècle : Verlaine et sa douzaine d’estampes, Pierre Loti et son roman best-seller Madame Chrysanthème… Tous sont fascinés par le Japon. Peu à peu, ce qui intéresse les écrivains, explique Chantal Viart dans sa biographie de Julien Vocance, c’est « d’écrire selon la façon dont les Japonais pratiquent la poésie ».
Immédiateté de la violence, cruauté abyssale des images de guerre, non-sens des situations… Ici, le haïku, dans son économie de mots et sa recherche de l’essentiel, se révèle comme un format optimal pour dire l’absurde et le trauma.
Chantal Viart, Julien Vocance, maître haïjin français, Éditions Unicité
strophe #25 – 18/11/2025
pareil à un navet
sorti de terre
exister
Nakamura Teijo
Quand, dans le petit monde du plus petit poème au monde, arrive un volumineux ouvrage appelé à devenir une référence, on s’y plonge illico ! Ainsi ai-je fait avec le Bouquin du haïku, qui vient de paraître et nous entraîne dans 1 632 pages passionnantes : origines du poème bref, récits des combats théoriques au Japon, des luttes entre revues et écoles… Surtout, biographies détaillées et commentaires d’haïkistes moins connus que les maîtres classiques, presque des contemporains (1994 étant la date de décès du plus récent d’entre eux). Pascal Hervieu, auteur de cette somme très documentée, vit au Japon depuis plus de trente-cinq ans et a eu la bonne idée de présenter enfin tous ces poètes mal connus en Occident. Parmi eux, cinq haïjines (dont les deux représentées ici), des femmes grâce auxquelles on découvre la difficulté à se faire entendre dans les cénacles très patriarcaux du haïku, mais aussi les tourments créatifs, la vie intérieure déchirée entre inspiration artistique et préoccupations maternelles…
le vent souffle du sud
la tristesse du lac
en moi tout le jour
Hachimoto Takako
Particulièrement captivantes dans cette « bible », les chroniques personnelles — presque au quotidien — de l’écriture de haïkus : comment celle-ci émerge-t-elle ? Quels mouvements du cœur ou du destin accompagne-t-elle ? Pourquoi génère-t-elle tant de passions, de conflits, d’espoirs ? Un seul regret : sans doute amoureux fou de la langue japonaise, de ses inflexions subtiles et de ses contraintes, le traducteur ne parvient pas toujours à adapter ces haïkus en un français apte à toucher l’âme poétique.
Pascal Hervieu, Le Bouquin du haïku, coll. Bouquins, Robert Laffont
Chronique hebdomadaire Le moment haïku sur strophe.fr de Pascale Senk.